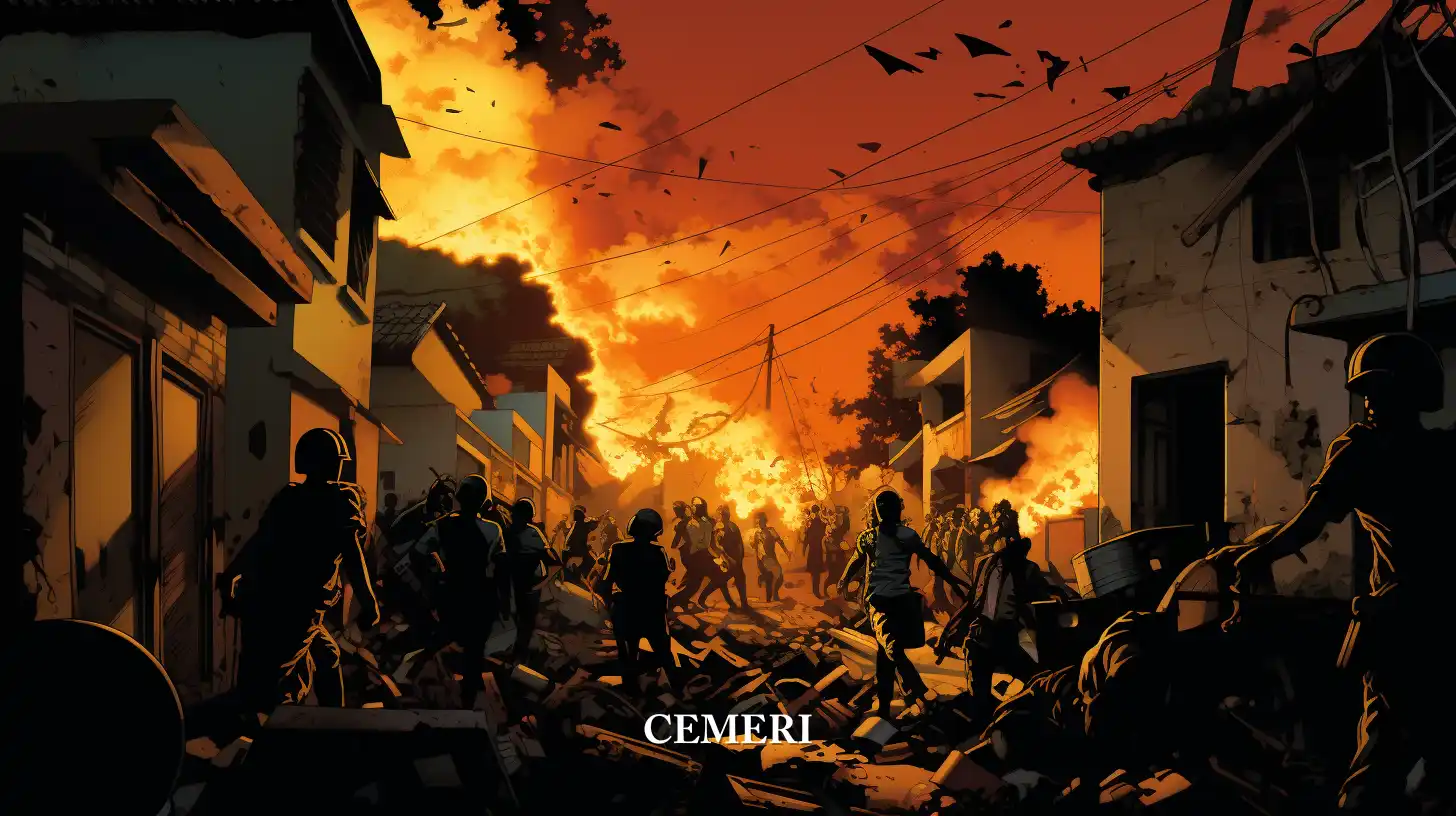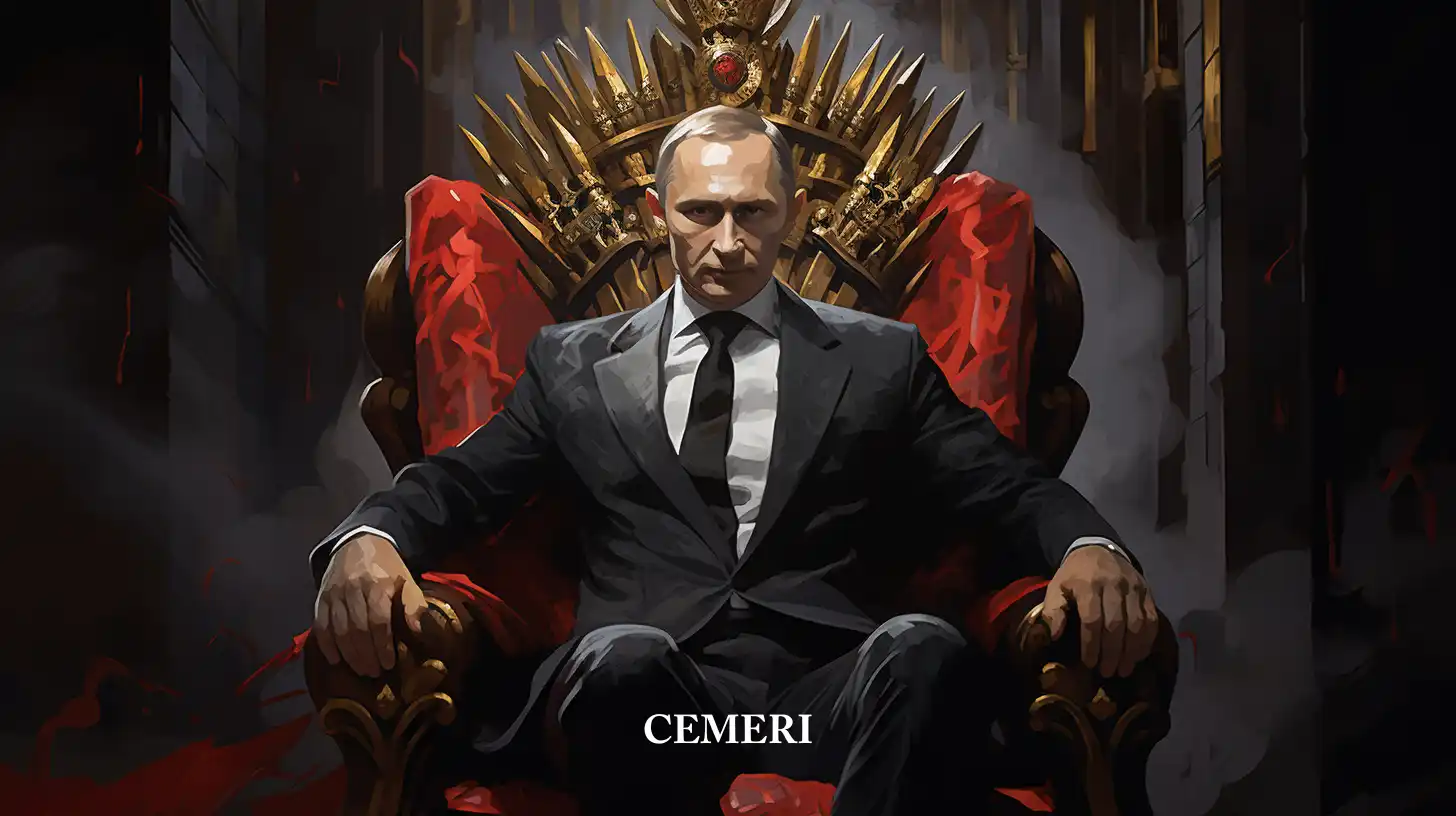Analyse
Paulina Villegas
Le discours des États-Unis face à la xénophobie : Japon et Inde
- Le président Joe Biden a qualifié deux de ses alliés, le Japon et l'Inde, de xénophobes
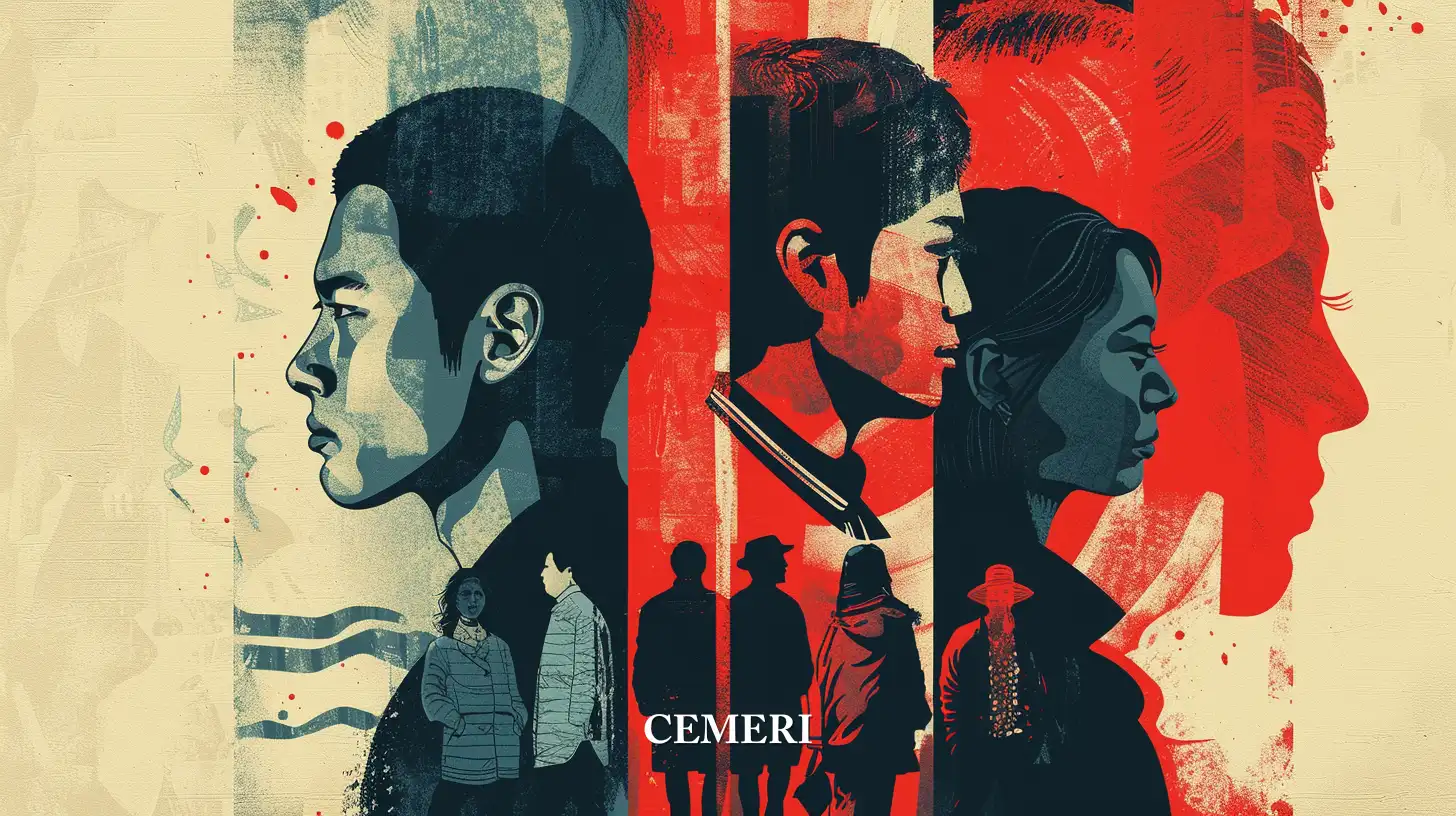
En plein sentiment d'incertitude politique et de sécurité dans le système international, Joe Biden, actuel président des États-Unis et candidat à la réélection, a affirmé lors d'un meeting adressé aux Américains d'origine asiatique, que la Chine et la Russie, principaux rivaux des États-Unis, sont économiquement stagnants parce qu'ils sont “xénophobes”.
Depuis les administrations passées, la Chine et la Russie ont été durement critiquées pour la promotion de valeurs antidémocratiques. Cependant, ce qui a attiré l'attention de la communauté internationale, c'est la déclaration de Joe Biden à propos de deux de ses principaux alliés; le Japon et l'Inde, les classant dans la même catégorie, celle des “États xénophobes”.
Cela a surpris beaucoup de monde car depuis le début de son administration, le président des États-Unis a souligné l'importance de renforcer ses relations avec le Japon et avec l'Inde, ce qui a conduit à diverses réunions avec leurs homologues, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre indien Narendra Modi.
Cependant, Biden affirme qu'il s'agit d'un argument basé sur le rejet indien et japonais face aux vagues massives de migrants qui viennent demander l'asile. Dans sa déclaration, le président des États-Unis souligne que le principal soutien des économies sont les migrants, car ils jouent un rôle important dans la solidification des économies.
Xénophobie asiatique : Les cas du Japon et de l'Inde
Selon le Fonds monétaire international, le Japon, l'une des économies prometteuses de l'Orient, présente actuellement une croissance économique de 0,9% contre 2,7% pour les États-Unis. Cependant, de tous les membres du G7, le Japon est la nation qui présente les niveaux de migration les plus bas, avec 2% de sa population composée d'immigrants contre 14% pour les États-Unis. Une différence multiculturelle entre les deux nations, mais qui ne qualifie pas le Japon d'État politiquement xénophobe.
Ces dernières années, le Japon a ouvert ses portes aux migrants pour compenser le vieillissement rapide de sa population. Bien que des sources nationales d'il y a quelques années aient révélé que 30% des étrangers interrogés par le gouvernement ont déclaré avoir été victimes de commentaires discriminatoires de la part de la population japonaise, une enquête du journal Asahi indique qu'aujourd'hui, 62% des Japonais sont d'accord pour admettre davantage de travailleurs étrangers. La promotion d'une éducation plus complète sur les droits de l'homme pour les Japonais, ainsi que la reformulation de leur politique migratoire extérieure, a positionné le Japon comme l'une des nations asiatiques qui reçoivent des immigrants sans conditions.
En revanche, l'Inde, actuellement le pays le plus peuplé du monde avec 1 449 830 616 habitants, a mis en œuvre sa nouvelle loi sur la citoyenneté, une initiative critiquée qui vise à naturaliser les personnes non musulmanes provenant d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. Bien que cette initiative représente une opportunité pour les migrants originaires d'Asie du Sud d'obtenir l'asile, il s'agit d'une loi discriminatoire en termes religieux et de droits de l'homme, un mécanisme juridique et constitutionnel qui donne la priorité et l'accès exclusif aux migrants hindous, sikhs et chrétiens, favorisant ainsi le confessionnalisme indien.
Le radicalisme religieux et identitaire en Inde remonte à l'époque du Raj britannique (1858-1947), qui s'est accentué depuis la partition avec son voisin le Pakistan en 1947, avec lequel il est actuellement en course à l'armement. L'application de politiques restrictives en matière de migration par l'Inde n'est pas niée, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis eux-mêmes, promoteurs de la démocratie et des valeurs universelles en faveur des droits de l'homme, ont sombré dans la xénophobie collective à plusieurs moments de leur histoire, et que la déclaration faite par l'actuel président Joe Biden dans le cadre de sa campagne de réélection, qui visait à sympathiser avec la communauté migrante en Amérique du Nord, a en partie ignoré ce que signifie sa relation forte avec deux de ses alliés les plus précieux en Asie.
Japon et Inde : alliances stratégiques, acteurs orientaux
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et les États-Unis ont solidifié leurs relations grâce à une coopération politique, scientifique et surtout commerciale.
La transition du Japon de l'Empire à l'État démocratique après l'occupation des Alliés entre 1945 et 1952 a favorisé son rapprochement avec les États-Unis ainsi que sa présence dans la sphère internationale, devenant ainsi l'une des économies orientales les plus solides de l'ère moderne. D'autre part, le succès de la relation est attribué à la démilitarisation japonaise par les États-Unis, une série de réformes à la constitution japonaise qui empêchait l'État d'utiliser sa force armée. Cela a non seulement réduit l'incertitude en termes de sécurité pour les États-Unis, mais a également marqué le début d'une relation économique-militaire profonde, qui a été formalisée par la signature du Traité de coopération et de sécurité mutuelle en 1951, une stratégie géopolitique pour arrêter le communisme croissant en Chine et freiner la présence soviétique en Asie dans le cadre des politiques de containment bien connues des États-Unis pendant la guerre froide.
Il en va de même pour l'Inde, une nation qui a connu une évolution politique à la suite de l'occupation anglaise sur son territoire. Les effets du célèbre Raj britannique ont eu quelques avantages qui ont façonné l'avenir de l'Inde, surtout en termes politiques et de modernisation du pays. La République démocratique qui en a résulté s'est caractérisée par l'adoption du développement de l'armement nucléaire comme axe directeur de la politique étrangère indienne en termes pacifiques, un précepte influencé par le principe de coexistence pacifique adopté après la Conférence de Bandung en Indonésie (1955).
La naissance d'une nation dotée de l'arme nucléaire en Orient a attiré l'attention des États-Unis, avec lesquels elle maintient actuellement une série d'accords, comme le traité nucléaire indo-américain, un accord nucléaire civil qui a renforcé la coopération stratégique énergétique et nucléaire entre les deux nations, et qui positionne l'Inde comme l'un des alliés clés des États-Unis.
Le Japon et l'Inde partagent des valeurs politiques communes avec les États-Unis. Ces derniers les considèrent comme des alliés inestimables en raison de leurs emplacements stratégiques en Asie, car l'Inde et le Japon ont été témoins de la croissance politique, économique et nucléaire abrupte de la Chine, défiant l'équilibre des pouvoirs et réduisant l'espace du Japon pour devenir une puissance économique régionale et celui de l'Inde pour devenir un hégémon continental.
Cependant, bien que les États-Unis voient en l'Inde et au Japon une grande opportunité de promouvoir la démocratie en Orient et de freiner l'expansionnisme chinois dans la région et à l'international en tant que membres actifs du Quad Security Grouping, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, les deux pays sont orientaux, et bien qu'ils partagent des idéaux politiques avec les États-Unis, la vision de la démocratie est différente car il s'agit d'une construction sociale provenant de l'Occident.
Les États-Unis ne se trompent pas dans la déclaration faite à l'égard de l'Inde, puisque leurs politiques migratoires se sont révélées de plus en plus discriminatoires. Cependant, les catégorisations qu'ils font envers deux de leurs alliés clés dans la région de l'Orient se révèlent être en partie divisives entre le monde occidental et le monde oriental, en raison de l'application de politiques migratoires restrictives de divers pays de l'Union européenne qui violent en grande partie les droits de l'homme, comme la politique controversée des réfugiés entre le Royaume-Uni et le Rwanda, une classification contradictoire lorsqu'il s'agit de distinguer l'Orient de l'Occident.
Sources
1. elDiario.es. (2017, 7 de abril). Crece el número de extranjeros en Japón, y también la xenofobia. https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/extranjeros-japon-comentarios-ministerio-justicia_1_3490176.html
2. Llandres, B. (s.f.). Japón y EEUU, 60 años de alianza – Artículo30. Articulo 30|Politica de Defensa. https://articulo30.org/politica-defensa/japon-eeuu-60-alianza-borja-llandres/
3. Northeast Maglev. (2019, 9 de julio). Una Amistad Entre Naciones: Relaciones con Japón y EE. UU. - Northeast Maglev. https://northeastmaglev.com/2019/07/09/una-amistad-entre-naciones-relaciones-con-japon-y-ee-uu/?lang=es
4. Patrick, P. (2014, 2 de abril). Japan won't forgive Joe Biden for his xenophobia gaffe. The Spectator. https://www.spectator.co.uk/article/japan-wont-forgive-joe-biden-for-his-xenophobia-gaffe/